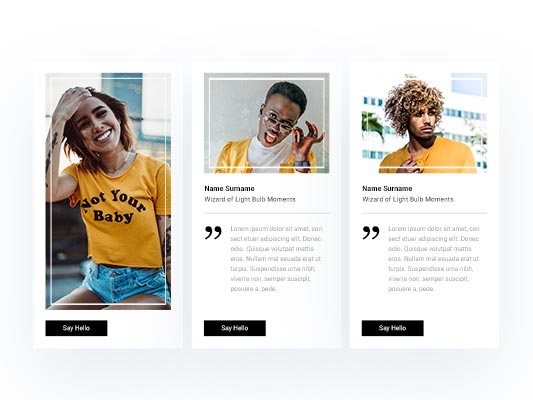Xavier Hamon envisage la cuisine comme d’un soin. Sensé pour un cuisinier devenu infirmier puis redevenu artisan-cuisinier. Aujourd’hui, son petit voyage d’une rive à l’autre de la santé alimentaire a pris l’ampleur d’une Université des sciences et des pratiques gastronomiques (USPG) à Quimper (Finistère), qu’il a fondé avec un collectif de cuisiniers engagés pour une alimentation saine et vivante (L’Alliance des tables libres et vivantes). Et il ne voit pas autrement l’exercice de sa fonction qu’en donnant toute son énergie pour l’autre.
Comment devient-on artisan-cuisinier après avoir été chef puis infirmier dans sa vie ?
J’ai un parcours très classique, plutôt en gastronomie traditionnelle française, avec tout ce qu’on peut connaître de prestige, mais aussi d’abus et d’atrocité dans une cuisine. Oui, d’atrocité. J’ai décidé alors de changer de métier et de me préoccuper des autres. Je suis devenu infirmier. Et dans ma pratique, ce qui m’intéressait, c’était plutôt l’aspect de la santé mentale.
Là, j’ai découvert un système de pensée qui s’appelle la systémie, qui n’est pas propre à la santé, qu’on retrouve aussi dans l’industrie. À partir de ce moment-là, j’ai tout pensé sous forme de système et non de fait isolé. Cela m’a beaucoup interrogé dans ma pratique d’infirmier, sur la théorie des systèmes et du symptôme. Le patient étant le symptôme d’un système et non pas le problème.
Je suis revenu à la cuisine avec l’héritage de cette pensée-là, systémique, en me disant que je voulais faire le pari d’exercer mon métier de cuisinier sans être dans un système de domination, de violence, de prestige, de concurrence, de compétition permanente. Je pouvais contribuer à nourrir, les gens autour de moi en tout cas, d’une autre manière. Oui, prendre soin.
Lire aussi : Finistèrestes, une coopérative au service des produits déclassés bretons
Comment décidez-vous alors de transformer votre métier ?
Je me suis servi de cette vision systémique pour essayer de questionner mon métier afin de voir si je pouvais l’exercer autrement, à tous les niveaux : les approvisionnements, évidemment, mais aussi la façon dont on vit dans une équipe, la relation avec les autres métiers de la filière, des filières, et comment tout ça s’articule. Et puis forcément aussi qui vit en systémique, qui étudie le système.
Le déclic s’est fait avec l’organisation Slow Food ?
Moi, je suis en Bretagne. Je suis au cœur de la matrice et j’en paye les conséquences comme les autres, mais peut-être un peu plus quand on est militant. J’ai trouvé dans le mouvement Slow Food un lieu où je trouvais des semblables, qui se posaient les mêmes questions que moi. Ils avaient justement cette vision très systémique, avec la mesure de l’impact de ce qu’on faisait au quotidien, ainsi que la remise en question des pratiques. Ce qui a changé considérablement ma façon d’exercer mon métier mais aussi de transformer les aliments, de travailler avec les gens.
Lire aussi : Aux États généraux du Post-Urbain, l’autonomie des campagnes de demain prend vie
En fait, l’idée est de commencer à sortir du principe que l’homme maîtrise la nature. Donc, ça oblige aussi à lire, y compris des ouvrages philosophiques, justement sur cette relation qu’on a avec la nature, pour la transformer en ce qu’il y a de plus noble, en ce que j’appelle la noblesse du métier d’artisan. C’est-à-dire articuler en permanence une pensée, une réflexion, presque une philosophie à son savoir-faire, à ses gestes, à son matériel, à son environnement.
« Notre première décision politique a été de nous débaptiser, de ne pas nous appeler « chefs », mais de nous appeler « cuisiniers » »
C’est tout ça que j’ai pu mettre en place dans ma tête et dans mon métier grâce à des rencontres que j’ai faites à Slow Food : des pêcheurs qui pensaient pareil – en tout cas, qui traversaient les mêmes questionnements – des éleveurs, des maraîchers, des semenciers, mais aussi des philosophes, des journalistes, des élus. Et c’est en ça que le lien avec Slow Food s’est fait naturellement.
Avec l’Alliance des cuisiniers (devenue aujourd’hui l’Alliance des tables libres et vivantes) que nous avions créée spécialement pour Slow Food, notre première décision politique a été de nous débaptiser, de ne pas nous appeler « chefs », mais de nous appeler « cuisiniers ». La déconstruction est un long cheminement, en fait.
Mais pourquoi vous en êtes-vous séparé ensuite ?
On s’est heurté à la représentation générale du métier de cuisinier qui n’a pas échappé au mouvement Slow Food et c’est en partie pour ça qu’il n’y a aucune reprise en France. On reste sur une vision du grand roman gastronomique français. C’est les égos qui ont primé, en fait.
Alors, à la suite de cela, vous avez mobilisé un collectif de cuisiniers autour de l’Alliance des tables libres et vivantes ?
Aujourd’hui, on pratique un métier, le métier d’artisan-cuisinier, qui n’est défini nulle part ailleurs que dans notre manifeste et qui ne correspond absolument à rien d’existant. C’est-à-dire que ce qui est enseigné aujourd’hui ne prend pas en compte ce qui nous a amenés, nous, à changer nos pratiques.
Le deuxième constat, c’était que pratiquer notre métier comme on le faisait – pour peu qu’on ne veuille pas uniquement parler à une élite économique et gastronomique – nous amenait à nous précariser. Car le combat face à l’environnement économique tel qu’il existe, sur le foncier commercial par exemple, est le même que sur le foncier agricole. On doit se battre sur plusieurs fronts à la fois. On doit aussi combattre le front idéologique qui voudrait faire croire que bien manger ne doit rien coûter.
Lire aussi : Jonathan Nossiter : « On doit rester dans son élan vital et c’est le plus important pour résister »
Par exemple ?
Je pense à nos légumes. On ne les paye pas encore assez cher. Mais si on commençait à payer le vrai prix que ça vaut, nos assiettes ne seraient plus accessibles. Sauf que dans le prix du menu, ce n’est pas encore ce qui coûte le plus cher parce que, travailler des légumes, ça demande de la main-d’œuvre compétente, qualifiée et conséquente, et ça se paye.
On sait que dans nos pratiques, ce qui coûte le plus cher, ce n’est pas la matière première mais souvent le loyer ou l’endettement lié au capital qu’on espère réaliser.
Toute cette adaptabilité au vivant est au cœur de votre réflexion et de votre travail. Vous ne pouvez pas faire le même poisson tous les jours. Ou même travailler les légumes de la même manière, puisqu’ils vont être liés aux aléas climatiques.
« On fait le constat du fossé énorme entre notre pratique, ce qui est transmis et ce qui se passe dans les organismes de formation»
Et par la suite, vous avez fondé l’Université des sciences et des pratiques gastronomiques (USPG) ?
En 2019, quand on écrit le manifeste, on fait le constat du fossé énorme entre notre pratique, ce qui est transmis et ce qui se passe dans les organismes de formation. Et à ce moment-là, on se dit qu’on essaierait bien de créer notre propre programme de formation et notre propre centre de formation et de réflexion sur le métier. Je me propose alors de travailler à la question.
Cette université des sciences et pratiques gastronomiques est basée à Quimper (Finistère) parce que ça participe aussi de la pensée, j’imagine. Parce que la démétropolisation des centres de décision et de formation ne sont pas non plus anodins.
Lire aussi : « Pour qu’une lutte puisse perdurer, il faut manger » : dans la campagne angevine, on milite en jardinant
C’est aussi là qu’on a pu développer une nouvelle ingénierie de formation. Parce qu’entre pratiquer le métier d’une certaine manière et le traduire en formation, c’est un autre métier, qu’on a appris. Et pour le coup, si on n’a pas cet ancrage territorial, fort, avec les autres métiers, on peut vite se perdre aussi dans une espèce de spécialisation en formation.
Vous entrez dans un autre métier à ce moment-là encore ?
Je ne suis pas né formateur, donc il a fallu que je le devienne. Et il a fallu garder en tête cette question du rapport au vivant et surtout du rapport entre les métiers. Et puis acquérir le sens de la transmission. Ce qui, en même temps, est assez lié à notre métier d’artisan.
Et comme on est sur le vivant, on ne peut être que sur les grands principes. Mais après, d’un territoire à un autre, on est bien obligé de transmettre que les choses bougent, que les définitions changent. Ce n’est pas la même chose de parler de local dans le nord que dans l’ouest, et encore moins dans la Drôme.
Or, parfois, c’est contradictoire. Vous travaillez avec du levain. Vous êtes pizzaïolo. Vous travaillez des variétés-population, uniquement des farines issues de paysans-boulangers qui vous fournissent. Et bien, le travail du levain… Le travail avec le vivant, il ne prend pas le même temps du 1er janvier au 31 décembre. Et donc on se doit de développer des pratiques qui vont dans ce sens.
« D’un territoire à un autre, on est bien obligé de transmettre que les choses bougent, que les définitions changent. Ce n’est pas la même chose de parler de local dans le nord que dans l’ouest, et encore moins dans la Drôme »
Et dans cette ingénierie de formation, l’idée est de casser les clichés inhérents à la formation de cuisinier, c’est cela ? Vous ne devez pas vous faire que des amis du coup ?
Ah ça non ! Et c’est pour ça que la force du collectif protège. Mais il faut changer tout cela. En cuisine, soit c’est le don de soi total à la cause, ce n’est même pas discutable, et on s’en aperçoit à 70 ans quand on est cassé de partout ou malade, qu’on n’a plus d’articulations. Soit on est dans un rapport au métier où t’as pas le choix, c’est à l’ancienne, et ce n’est même pas en lien avec le vivant, c’est juste en lien avec une soumission au travail.
Et moi, je soulève un autre point, si on veut travailler avec le vivant, parfois il y a des aléas, la saisonnalité, une erreur humaine, ça peut arriver, mais comment on fait ? Et j’en veux beaucoup aux organisations syndicales qui ne veulent pas s’attacher à cette question-là. Y compris dans celles qui se disent écolo, et bien, la question du vivant n’est pas intégrée. Et on ne s’en sortira pas uniquement avec des bonnes pratiques individuelles : je n’y crois pas deux secondes, ça ne marche pas.
Vous cherchez donc des partenaires pour faire avancer votre cause ?
Pour travailler avec le vivant et pour nourrir le plus grand nombre, on a besoin de main-d’œuvre compétente. Et beaucoup de main-d’œuvre. Donc c’est un secteur d’emploi très très riche, à condition qu’à un moment donné, collectivement, politiquement, des organisations se posent la question de savoir qui paye.
Avec l’USPG, on a développé des programmes de formation pour la restauration. On intervient par exemple dans le secteur de la restauration collective. C’est un enjeu et surtout, là, on peut vraiment toucher du monde.
Et là, je trouve – même s’ils ne sont pas non plus majoritaires – une quantité d’élus avec lesquels on peut discuter de ces questions-là. C’est-à-dire qu’ils ont les réponses. On voit bien comment les collectivités ont du mal, avec la baisse des sous-solutions de l’État, à faire leur job. Mais au moins, ils se posent la question.
Lire aussi : Bien manger, le champ des possibles des élus
Pensez-vous que vous pouvez aider à faire basculer les choses ?
Nous, on est 70 cuisiniers dans l’association. Quand bien même, on parlerait à 300 cuisiniers, ça ne va pas bien loin. On travaille de près aussi avec des éleveurs de race locale de Bretagne. Ce sont des gens calés politiquement, calés techniquement. Mais ça ne fait jamais que 50 éleveurs. Et je crois que s’il n’y a pas une association, une alliance politique de ces courants-là, on peut être plus méchant, on peut taper du poing sur la table. J’ai bien l’intention qu’on gagne beaucoup plus, à plus grand nombre, pour changer la donne.
Photo bannière : Xavier Hamon est un cuisinier engagé @Crédit photo : Anne Claire Héraud